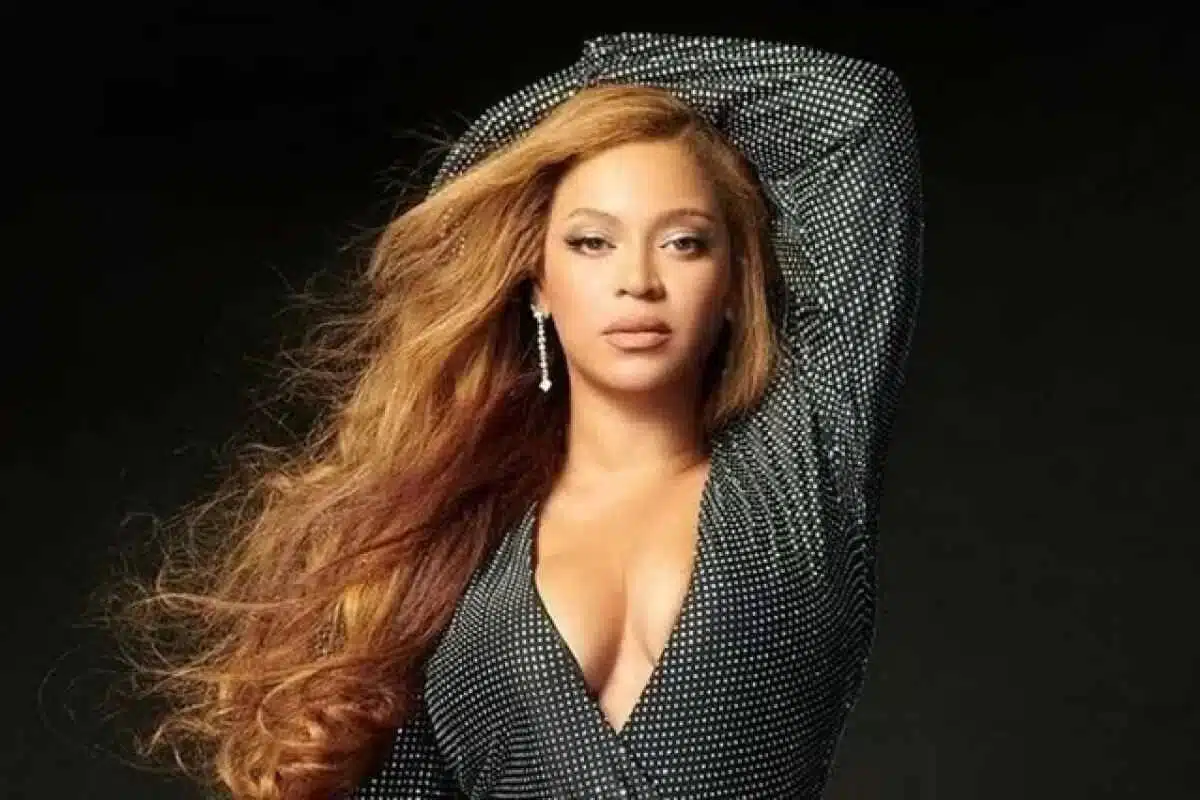Les statistiques n’offrent aucun répit : près d’un homme sur deux sera concerné par la calvitie au cours de sa vie. Derrière ces chiffres, il y a des regards fuyants dans le miroir, une image de soi qui vacille et, souvent, un sentiment d’impuissance. Pourtant, la médecine esthétique a fait de la greffe de cheveux une réalité accessible, loin des faux espoirs ou des promesses vaines. L’enjeu ? Choisir la méthode adaptée à sa situation, comprendre les différences et savoir à quoi s’attendre, sans tabou ni jargon inutile.
La méthode FUSS (Follicular Unit Strip Surgery)
La FUSS, ou Follicular Unit Strip Surgery, consiste à prélever une bande de cuir chevelu à l’arrière de la tête. Cette méthode, souvent utilisée pour se faire greffer des cheveux, débute par le rasage de la zone donneuse. Le chirurgien retire alors une fine bande de peau, généralement autour de la nuque ou près des tempes, jamais plus large que deux centimètres. La zone est ensuite refermée à l’aide de points de suture, ce qui laisse une cicatrice fine, le plus souvent masquée par les cheveux alentours.
La bande de cuir chevelu n’est pas implantée telle quelle : elle est minutieusement découpée sous microscope pour en extraire les unités folliculaires. Selon les fragments, chaque unité peut comporter un à quatre bulbes. Le praticien répartit ensuite ces unités de manière irrégulière à l’aide d’une aiguille spécifique, car une implantation trop régulière donnerait un aspect peu naturel. Pour un résultat harmonieux, les greffons sont placés plus densément à l’avant, plus espacés vers l’arrière, imitant ainsi la densité d’une chevelure intacte. Cette technique s’adresse surtout aux personnes avec une calvitie peu avancée ou localisée.
La méthode FUE (Follicular Unit Extraction)
Avec la FUE, ou Follicular Unit Extraction, chaque greffon est prélevé séparément. Le processus commence par un rasage de la nuque, puis le médecin utilise un petit instrument cylindrique, d’un à deux millimètres de diamètre. Ce micro-bistouri permet de prélever un à un les bulbes capillaires, qui seront ensuite implantés dans les zones à combler selon une répartition dense et discrète.
Le résultat dépend du respect de l’orientation naturelle des cheveux : chaque greffon doit être replacé dans le bon sens pour préserver l’harmonie de la chevelure. Si la nuque rasée reste visible quelques jours, cette méthode ne laisse pas de cicatrice linéaire, contrairement à la FUSS. L’intervention prend du temps : il faut compter au moins cinq heures par séance, durant lesquelles 2 000 à 3 000 greffons peuvent être transplantés.
La méthode FUE automatisée
La FUE automatisée reprend les principes de la FUE classique, mais introduit un outil motorisé qui aspire les bulbes au lieu de les extraire manuellement. Une fois la nuque rasée, le praticien utilise cet appareil pour prélever rapidement les follicules, qui sont ensuite réimplantés en respectant l’équilibre naturel de la chevelure.
Ce dispositif automatisé réduit la durée des séances et favorise, dans bien des cas, la vitalité des bulbes grâce à la rapidité du prélèvement. Cette technique s’adresse en particulier à ceux dont la perte de cheveux reste modérée ou limitée.
La FUE sans rasage visible
Pour ceux qui souhaitent éviter l’aspect “nuque dégarnie” après une greffe, une variante de la FUE a vu le jour. Dans ce cas, le rasage s’effectue par petites bandes, dissimulées sous les cheveux existants. Cette méthode permet de prélever les greffons sans que la coupe de cheveux ne soit altérée, car la chevelure du dessus masque les zones rasées.
Le reste de l’intervention suit les mêmes étapes : les unités folliculaires sont implantées avec soin, en reproduisant la répartition naturelle des cheveux. Il faut rappeler que la greffe de cheveux relève de la chirurgie esthétique et doit se pratiquer dans des établissements agréés par la Haute autorité de santé, un gage de rigueur et de sécurité.
La greffe de cheveux à partir de la barbe ou du corps
Une autre possibilité prend de l’ampleur : le prélèvement de poils sur d’autres parties du corps pour densifier une zone dégarnie. La barbe, le torse, voire les jambes, deviennent des alternatives lorsque la zone donneuse classique, la nuque ou les tempes, ne suffit plus.
Ce recours ouvre la greffe capillaire à des profils jusque-là exclus, notamment les personnes qui manquent de densité au niveau du cuir chevelu. Il n’est pas rare aujourd’hui d’utiliser la barbe pour reconstruire une ligne frontale, ou de combiner plusieurs parties du corps pour traiter une calvitie plus marquée.
Cette méthode reste cependant moins fréquente, réservée à des situations spécifiques ou à des besoins particuliers. Pour trouver la solution la plus adaptée, il est indispensable de s’adresser à un spécialiste expérimenté.
Les risques et précautions avant une greffe de cheveux
Comme toute intervention chirurgicale, la greffe de cheveux comporte des risques. Le choix du praticien doit donc être fait avec soin : il faut se tourner vers un professionnel reconnu, formé et expérimenté, afin de réduire les complications postopératoires. Un état de santé stable est également nécessaire, notamment pour limiter les risques liés à l’anesthésie.
Avant l’opération, quelques mesures simples permettent d’optimiser la récupération et d’éloigner les complications :
- Arrêter la cigarette au moins deux semaines avant et après la greffe, pour favoriser la cicatrisation et limiter les infections.
- Programmer une consultation approfondie avec le chirurgien, qui étudiera l’historique médical et vérifiera l’absence de contre-indications.
Les recommandations du professionnel doivent être respectées scrupuleusement, du premier rendez-vous jusqu’à la phase de récupération complète. Cette rigueur reste le meilleur atout pour un résultat naturel, sans mauvaise surprise.
Au terme de ce parcours, ce sont parfois des années de doutes qui s’effacent progressivement, mèche après mèche. Reste alors à se réapproprier son image, et peut-être à retrouver la légèreté d’un simple geste : passer la main dans ses cheveux, sans y penser.